• On compare parfois la gestion des finances d'un Etat à la tenue des comptes d'un ménage ou d'une entreprise.

Un excès d'endettement devrait donc être combattu rapidement par des économies importantes.
• Les pays matures (Etats-Unis, zone euro, Grande Bretagne…), ayant atteint un niveau d'endettement excessif, devraient donc, alors même que la croissance est faible, s'engager dans des politiques énergiques de réduction des déficits, principalement appuyées sur des réductions de dépenses.
• Cette idée qui semble de bon sens, laisse de côté la dimension temporelle dans laquelle s'inscrit l'action des Etats.
L'histoire peut de ce point de vue être une bonne source d'enseignements : en témoignent certains exemples d'assainissement budgétaire, permis par l'inflation.
Depuis la fin des années 1990, les pays développés sont entrés dans une phase de détérioration durable de leurs finances publiques.
A la veille de la crise financière de 2008, celles-ci étaient dans une situation déjà tendue, qui n'a fait que s'aggraver par la suite.
Cette dégradation est le résultat d'un enchaînement à peu près identique dans ces pays.
La menace d'implosion du système financier international a obligé les Etats à absorber les dettes bancaires.
L'entrée en récession de l'économie mondiale a dans le même temps contraint l'ensemble des Etats développés à mettre en place des plans de relance, au moment où leurs recettes reculaient du fait du repli de l'activité économique.
La combinaison des ces trois facteurs a eu pour effet, dans des pays comme la France ou l'Allemagne, de faire passer le ratio dette sur PIB de 60% avant la crise à 85% après celle-ci.
La suite est bien connue même si l'on a observé, au sein des pays développés, une trajectoire un peu différente dans les pays anglo-saxons et en Europe continentale.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont en effet bénéficié de deux éléments : le recyclage des réserves de changes des pays émergents en bons du Trésor et la mise en œuvre de politiques non-conventionnelles (rachats d'obligations souveraines) par la Réserve Fédérale et la Banque d'Angleterre.
L'Europe continentale s'est différenciée sur ce point.
D'un côté, l'union monétaire n'a pas empêché une attaque en règle des titres souverains des pays les plus faibles au sein de la zone euro.
Ensuite, la BCE, respectant l'orthodoxie héritée de la Bundesbank, s'est longtemps abstenue d'intervenir en rachetant des obligations souveraines, afin de se prémunir contre l'aléa moral qui consiste à prêter aux pays les moins vertueux.
La crise des spreads et les aides aux pays en difficulté qui en résulte, suggèrent une réponse par la mise en œuvre de politiques d'austérité plus ou moins sévères selon les cas.
Il faut agir comme on le ferait pour un ménage surendetté.
Cette recette vaudrait pour tous les pays, y compris ceux qui, comme l'Allemagne, disposent en fait de certaines marges de manœuvre.
Le parallèle entre les finances d'un ménage et celles d'un Etat n'est en fait pas pleinement valide.
Les Etats disposent de beaucoup de temps pour régler leurs problèmes budgétaires.
Et la politique monétaire est susceptible de faire varier le taux d'inflation, contribuant à l'amélioration du ratio dette sur PIB.
L'histoire est riche d'enseignements sur ce plan.
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, le ratio dette sur PIB de la Grande-Bretagne atteignait environ 250%.
En une cinquantaine d'année, le pays a profité d'un taux de croissance économique annuel moyen de 2,5% et surtout d'une inflation de 6%, lui permettant de ramener son taux d'endettement à environ 40% en 2000.
Ce qui est possible pour un Etat (générer de l'inflation et lever des impôts pour financer la relance de l'activité), ne l'est pas pour un ménage.
Le cas américain est également une source d'enseignement.
En 1946, le taux d'endettement des Etats-Unis atteint 125%.
En 2003, il n'était plus que de 36%.
Pourtant, durant cette période, le budget fédéral était en moyenne déficitaire à hauteur de 1,6% du PIB.
La réduction des déficits n'est pas venue de la réalisation d'un excédent budgétaire (l'excédent primaire était de 0,3% et les intérêts de la dette de 1,9% du PIB en moyenne), mais bien d'une croissance nominale élevée.
En moyenne, depuis l'après-guerre, les Etats-Unis ont bénéficié d'une croissance réelle de 3,6% et d'un taux d'inflation moyen de 3,8%.
L'inflation a été le principal moteur de désendettement des Etats-Unis, depuis l'après-guerre jusqu'au début des années 2000.
L'Europe saura-t-elle tirer un enseignement de ces expériences.
La morale de ces histoires montre qu'engager des plans d'austérité trop drastiques peut s'avérer contre-productif.
Faire des économies et ne pas vivre au-dessus de ses moyens est un objectif totalement légitime.
Etudier les moyens utilisables pour faire monter le taux d'inflation est sans doute également nécessaire.
Le dénominateur du ratio dette sur PIB doit augmenter suffisamment pour ne pas mettre en péril la résorption de la dette.
La zone euro souffrant d'une croissance potentielle basse (autour de 1,5%), la dette publique de l'ensemble de la zone ne se fera pas aisément sans une inflation plus élevée.
Dans le cas des Etats-Unis, certains économistes ont préconisé de fixer un objectif d'inflation compris entre 4% et 6%.
Si l'Europe ne change pas de doctrine économique (en abandonnant l'objectif de 2% d'inflation de la BCE), on risque de voir s'opérer une dichotomie profonde au sein des pays développés, entre ceux qui savent et sont prêts à générer plus d'inflation, et ceux qui s'enferment dans l'excès d'austérité (qui serait une menace pour tous leurs partenaires commerciaux).
C'est le sens des messages adressés récemment par Barack Obama et Tim Geithner aux dirigeants européens.
Pour l'instant c'est la BCE qui traite le problème de spread de la zone euro par ses achats de dette souveraine (italienne notamment).
Celui-ci ne trouvera sans doute de réponse définitive qu'avec la création d'une agence de la dette qui émette des titres pour les pays de la zone (eurobonds).
Au-delà, l'objectif d'inflation de la BCE devra faire l'objet d'une réflexion car 2% est un niveau trop bas.
Les étapes à franchir sont très importantes, et c'est seulement sur le très long terme que les problèmes pourront être vraiment résolus.






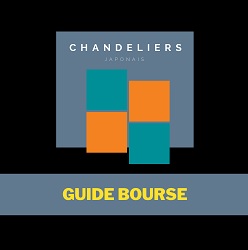

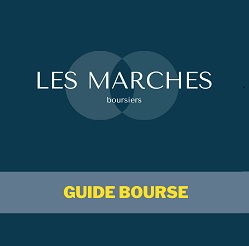
0 Commentaire